Le côté obscur du développement international
Comment l’aide au développement encourage les structures de pouvoir colonial

par Caitlin Reid (elle), Conseillère en médias et communications d’OSSTF/FEESO
Lorsque j’étais étudiante à l’école secondaire et à l’université dans les années 2000 et au début des années 2010, l’idée d’aider les personnes les plus démunies dans le monde présentait un attrait incontournable. Des programmes d’études à l’étranger aux voyages plus spécifiques de « volontourisme », ces vacances où l’on pouvait faire du bénévolat à l’étranger, souvent dans une école, un hôpital ou un orphelinat offraient d’innombrables possibilités de voyager partout dans le monde tout en procurant aux touristes le sentiment qu’ils faisaient une différence.
Dans les médias sociaux, c’était la même histoire, chaque post semblait être les plus récentes photos de votre ami(e) lors de son voyage à l’étranger où elle/il aidait à construire une école ou à creuser un puits pour qu’un petit village en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine puisse avoir accès à de l’eau potable. C’est même devenu une photo standard sur les applications de rencontre, où les personnes (pour la plupart) blanches se vantaient d’être philanthropiques et altruistes en incluant sur leur profil des photos d’elles-mêmes en train d’aider des enfants dans les pays du Sud.
Mais l’appel à contribuer à quelque chose de plus grand que moi était plus fort que quelques voyages de bénévolat par an. Nombre de mes amis et moi-même avons étudié les problèmes mondiaux, obtenu plusieurs diplômes en développement international et consacré nos carrières à la réduction de l’écart de richesse entre les pays riches et industrialisés du Nord et les pays à faible revenu et moins industrialisés du Sud.
Nous étions loin de nous imaginer que la cause à laquelle nous consacrions notre vie et notre carrière contribuait en grande partie à l’écart de richesse mondial. Nous ne savions pas que souvent, l’aide étrangère—lorsque les pays riches donnent de l’argent pour des projets humanitaires ou de développement—ne sert qu’à dissimuler les activités commerciales et politiques plus néfastes des pays et des entreprises dans les pays à faible revenu. Nous ne comprenions pas non plus l’impact du colonialisme sur le développement international et le fait que les anciens déséquilibres de pouvoir coloniaux encadrent encore de nos jours la plupart des interactions entre le Nord et le Sud.
Nombreux sont ceux qui pensent que le colonialisme est l’antithèse du développement international. Personnellement, j’ai reçu de nombreuses affirmations positives de la part d’étrangers et d’êtres chers pour le simple fait de travailler dans le secteur international à but non lucratif. Mais la vérité est que le secteur du développement international, tel que nous le connaissons, s’est développé à la fin de la période coloniale européenne et ne s’est jamais totalement détaché de cette dynamique de pouvoir. En fait, ce secteur reproduit souvent le colonialisme au lieu de le démanteler.
Lorsque les puissances européennes ont découpé les terres et tracé des frontières sur les cartes du monde, elles ont délibérément créé des frontières nationales arbitraires qui répondaient principalement à leurs besoins en matière d’extraction de ressources et qui ignoraient ou divisaient intentionnellement les groupes ethniques et les terres traditionnelles. Lorsque les empires se sont effondrés, les entreprises européennes et nord-américaines sont souvent restées sur place pour continuer à extraire des ressources précieuses par billions de dollars.
En fait, l’industrialisation du Nord a été alimentée par les ressources extraites du Sud. Dans un article paru en 2021 sur Al Jazeera, on estime que depuis 1960, plus de 152 000 billions de dollars américains ont été prélevés dans les pays du Sud et envoyés dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Les milliards de dollars donnés chaque année aux pays du Sud peuvent sembler importants, mais lorsqu’on les replace dans leur contexte, ils ne représentent qu’une fraction de la richesse créée dans le Nord en épuisant les ressources naturelles précieuses des pays à faible revenu et en tirant parti d’une main-d’œuvre bon marché.
Le Canada n’est pas à l’abri de ces forces mondiales. Lorsque M. Stephen Harper était Premier ministre, le gouvernement canadien a clairement indiqué que l’aide étrangère serait liée aux intérêts commerciaux du Canada, et non aux intérêts des bénéficiaires de l’aide, ce que la plupart des gens considèrent comme la raison d’être de l’aide étrangère.
Un rapport interne de 2013 de l’Agence canadienne de développement international (qui fait désormais partie d’Affaires mondiales Canada) indique que les intérêts commerciaux du Canada sont devenus un élément clé pour déterminer le montant d’aide qu’un pays en voie de développement recevra (Canadian International Development Agency).
Le gouvernement Harper a ensuite accordé la priorité à l’aide destinée aux pays où les sociétés minières canadiennes avaient des intérêts, notamment la Mongolie, le Pérou, la Bolivie, le Ghana et la République démocratique du Congo. Des organisations à but non lucratif mettant en valeur l’importance de la lutte contre la pauvreté et de la durabilité écologique ont été invitées à s’associer à des sociétés minières dans le cadre de projets pilotes dans ces pays afin de recevoir des fonds d’aide étrangère.
Depuis des décennies, l’on accuse les sociétés minières canadiennes d’être de grands pollueurs et de nuire à la santé des communautés locales. Elles ont également été accusées de fermer les yeux lorsque des militant(e)s anti-mines ont été assassinés dans les pays du Sud. Sous Harper, il était clair que les intérêts de ces entreprises, aussi destructeurs ou nuisibles soient-ils, seraient prioritaires par rapport aux effets néfastes sur les terres et les communautés locales.
En tant que jeune professionnelle au début des années 2010, il était évident qu’un changement s’imposait dans le secteur. L’accent était presque entièrement mis sur l’élection d’un nouveau gouvernement, et non sur le système lui-même. En 2015, je travaillais à la Mission du Canada auprès des Nations Unies à Genève. Stephen Harper était encore Premier ministre et il y avait un désir de changement palpable et non exprimé parmi les agent(e)s du service extérieur. Plus tard dans l’année, notre souhait a été exaucé lorsque M. Trudeau a été élu Premier ministre. Nous avons tous été inspirés par les changements qu’il promettait d’apporter au secteur et aux peuples du monde entier.
Malheureusement, comme pour beaucoup d’autres situations préoccupantes, le gouvernement Trudeau n’a pas répondu aux attentes. Les déséquilibres de pouvoir renforcés dans le secteur international se sont avérés redoutables et son gouvernement a fait très peu pour changer cette réalité.
L’Éthiopie a été l’un des principaux bénéficiaires de l’aide sous Trudeau. Le Canada a également investi des sommes importantes dans le secteur minier éthiopien. En 2016, Affaires mondiales Canada a investi 15 millions de dollars dans le secteur minier éthiopien, et le programme a été renouvelé et prolongé en 2020. L’aide et les investissements ont continué d’affluer même après que le gouvernement a fait entrer ses armées dans la région du Tigré et a déclenché la guerre la plus meurtrière du 21e siècle.
On estime que plus de 600 000 civils ont été tués dans ce conflit, et que l’armée du gouvernement s’est livrée à un nettoyage ethnique et à des viols militarisés. De nombreux Canadiens seraient probablement choqués d’apprendre que pendant cette période, M. Trudeau a « affirmé l’amitié profonde et durable entre le Canada et l’Éthiopie » (Open Canada).
À l’époque, un porte-parole d’Affaires mondiales Canada a confirmé que les sociétés minières canadiennes ayant des intérêts dans la région du Tigré avaient reçu une certaine forme d’aide du gouvernement fédéral. Une fois de plus, les intérêts canadiens l’emportent largement sur les droits des citoyens locaux. Même face au génocide et au viol militarisé, le gouvernement canadien continue de privilégier les intérêts commerciaux au détriment des droits les plus fondamentaux des êtres humains.
Le changement auquel nous avons tous cru et qui nous a inspiré en 2015 a fini par perpétuer les mêmes horreurs, et parfois même elles ont empiré, puisque Trudeau a permis à un gouvernement accusé de génocide par les États-Unis et l’Union européenne d’obtenir de l’aide étrangère.
Personnellement, j’ai quitté le secteur en 2020 puisque j’ai voulu me concentrer sur les questions nationales et sur les domaines dans lesquels je pouvais avoir un impact plus important dans ma propre communauté. Mais je ne doute pas que mes collègues qui sont restés dans le secteur n’auraient jamais imaginé s’aligner sur des gouvernements et des organisations qui ont directement ou indirectement contribué à un génocide et à des viols armés.
Je suis également convaincue que les organisations d’aide qui acceptent l’argent de gouvernements cherchant à consolider leurs intérêts miniers et commerciaux au détriment de la vie de communautés locales doivent être tenues responsables de leurs actions. Il est inadmissible d’accepter que les programmes proposés par ces organisations d’aide soient si importants qu’il est normal qu’elles continuent d’accepter des fonds d’aide qui contribuent à soutenir des autocrates brutaux.
Si les activités minières du Canada sont à l’origine d’une pollution massive à l’étranger, comment les programmes environnementaux d’une organisation à but non lucratif pourraient-ils compenser ces dommages? Si le Canada donne des milliards de dollars à un régime accusé de génocide et de viols massifs, comment un programme d’égalité des sexes géré par un organisme canadien à but non lucratif pourrait-il vraiment compenser pour les dommages subis par les victimes de viols?
Si nous voulons apporter une contribution positive à l’étranger, nous ne pouvons pas faire semblant ou négliger l’impact réel de notre pays dans ces mêmes endroits. Il n’est pas acceptable de penser que nos propres objectifs personnels ou professionnels puissent justifier la destruction massive causée par les grandes entreprises ou les gouvernements autocratiques soutenus par les pays riches.
De nos jours, lorsque je pense à la solidarité internationale, je ne pense plus aux images attrayantes de volontourisme qui inondaient mes fils d’actualité. Je pense aux militant(e)s et aux travailleuses et travailleurs du Sud qui mènent leur propre combat pour la justice, souvent contre les gouvernements et les entreprises qui ont leur siège social dans notre pays. Je pense à la manière dont je peux utiliser ma position, mes privilèges et ma voix pour soutenir ces luttes, non pas en me centrant sur elles, mais plutôt en travaillant au démantèlement des systèmes qui alimentent l’inégalité dans notre pays et à l’étranger.
C’est là que les syndicats peuvent et doivent intervenir. Nous ne sommes pas redevables de l’argent des entreprises ou du gouvernement fédéral pour contrôler où et comment nous opérons au niveau international. Nous devons reconnaître cette dynamique et refuser d’en être complice. La véritable solidarité ne consiste pas à faire figure de sauveur, mais à comprendre les forces systémiques en jeu et à travailler aux côtés de nos camarades du Sud pour les remettre en question. Cela signifie qu’il faut :
- Apprendre avant d’agir—Nous devons aborder la solidarité internationale avec humilité, en reconnaissant que nous avons souvent plus à apprendre qu’à enseigner. Les luttes des travailleuses et travailleurs des pays à faible revenu ne sont pas fondamentalement différentes des nôtres, et leurs stratégies d’organisation peuvent nous offrir de précieuses leçons.
- Combattre à domicile d’abord—L’un des moyens les plus efficaces de soutenir la justice internationale est de s’attaquer à la manière dont notre propre pays contribue à l’exploitation mondiale. Il s’agit notamment de contester les politiques commerciales injustes, de plaider en faveur de pratiques d’investissement éthiques et de demander des comptes à nos gouvernements pour les politiques qui perpétuent les inégalités économiques et sociales à l’étranger.
- Remettre en question le narratif sur l’aide au développement—Au lieu de soutenir sans esprit critique des programmes de développement susceptibles de renforcer les structures coloniales, nous devrions plaider en faveur de partenariats directs avec des organisations de base dans le Sud. Le soutien devrait être orienté en fonction des besoins et des priorités de ces communautés, plutôt que dicté par des acteurs non-résidents venant du Nord.
- Résister à la mainmise des entreprises sur le développement—De nombreuses initiatives d’aide sont motivées par des intérêts commerciaux plutôt que par de véritables objectifs de développement. Nous devons veiller à ce que nos partenariats internationaux ne renforcent pas par inadvertance les pratiques d’exploitation du travail ou la destruction de l’environnement.
La solidarité internationale n’est pas un acte de charité, c’est un engagement pour la justice. Elle nous oblige à voir les liens entre l’exploitation mondiale et nos propres luttes en tant que travailleuses et travailleurs. Si nous voulons soutenir nos collègues du Sud, nous devons d’abord démanteler les systèmes d’inégalité que nos propres pays contribuent à maintenir.
En remettant en question les récits dominants sur l’aide et le développement, nous pouvons aller au-delà de la solidarité performative et travailler à un véritable changement systémique. Cela signifie travailler en véritable partenariat avec ceux qui luttent pour la justice économique et sociale dans le monde entier, en reconnaissant que leurs luttes ne sont pas séparées des nôtres, mais qu’elles sont profondément imbriquées.
La lutte pour un monde plus juste commence par la compréhension de la manière dont la richesse et le pouvoir circulent réellement et par le refus d’être complice des structures qui perpétuent l’inégalité. Cette vérité doit inspirer la manière dont nous, en tant qu’organisations syndicales, nous engageons et soutenons l’aide mondiale, ainsi que la manière dont nous situons nos efforts de solidarité internationale. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons construire un mouvement enraciné dans une véritable solidarité internationale, un mouvement qui améliorera la situation de tous les travailleuses et travailleurs, quelles que soient les frontières.
CITATIONS
Naranjo, José. “Ethiopia’s forgotten war is the deadliest of the 21st century, with around 600,000 civilian deaths.” El País, 27 Jan., 2023, https://english.elpais.com/international/2023-01-27/ethiopias-forgotten-war-is-the-deadliest-of-the-21st-century-with-around-600000-civilian-deaths.html
Zelalem, Zecharia. “Trade Trumps Human Rights for Trudeau in Ethiopia’s Civil War.” Open Canada, April 13, 2022, https://opencanada.org/canada-ethiopia-civil-war/
Canadian International Development Agency. CIDA: 2013 Internal Report. Global Affairs Canada, 2013.

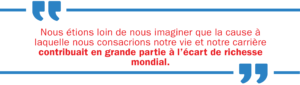
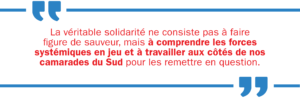
Leave a comment